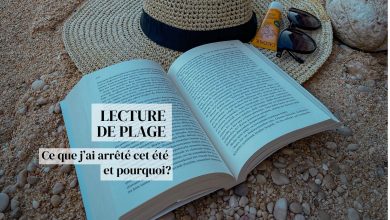La harira, jaunâtre et au goût âpre, la Chabakia réservée à l’élite, un régime à base de pain et de fruits, du couscous au quotidien dans les campagnes, le poisson inconnu de la population… la table du ramadan a subi une mutation profonde avec l’arrivée du protectorat. Pour le meilleur et pour le pire.
À l’ère des offres de ftour à 1300 DH, du gaspillage de la nourriture à tout-va, des hypermarchés à donner le tournis en raison de l’embarras du choix… l’on serait mené à penser que l’opulence affichée dans les tables de ftour a toujours été de rigueur chez les familles au Maroc. Pourtant, avant l’arrivée du protectorat français en 1912, la composition de la table des Marocains durant le mois sacré était d’une toute autre réalité.
«La table était sombre durant le ramadan. Dans les villes, la harira faisait partie du menu, sauf qu’elle avait un goût âpre et elle était de couleur jaune. On l’appelait «la harira lhamda, cette soupe originaire de Fès est préparée à base de féculents légumineux (pois chiche, lentilles sèches…) et montée par la farine. Quant à sa couleur, elle n’a viré au rouge qu’avec l’entrée de la tomate au Maroc grâce au protectorat qui a ouvert les marchés du pays sur le commerce avec l’étranger», analyse Mohamed Houbaida, professeur à la faculté des lettres et des sciences humaines de Kénitra.
Dans son livre « Le Maroc végétarien, 15ème-18ème siècle », Mohamed Houbaida, livre un témoignage rare et passionnant sur les habitudes nutritionnelles des Marocains pendant le mois du ramadan, entre autres.

À la campagne, la table était d’une routine implacable, puisque les paysans mangeaient quotidiennement du couscous à base de blé pour les zones où l’agriculture est prospère, pour le reste, l’orge était la valeur refuge. «L’économie précoloniale était dominée par la rareté en raison de la culture vivrière pratiquée par les paysans marocains», précise notre source. En effet, les denrées alimentaires couvraient à peine les besoins, et même les produits issus de l’élevage, comme les œufs ou la viande, étaient des produits de «luxe», puisque les paysans préféraient les vendre dans les souks pour survivre, plutôt que de les consommer.

En plus du couscous, dans le milieu rural le complément alimentaire était composé de fruits avec du pain. Une tradition encore monnaie courant dans certaines régions du Maroc où les gens mangent de la pastèque, le melon et les raisins avec du pain. Ce qui fait dire à Mohamed Houbaida que les Marocains sont historiquement des végétariens.
Pas de sucre et de poisson à la carte
Un produit va bouleverser la santé des Marocains et qu’on peut mettre à l’actif de l’arrivée du protectorat également: le sucre. «Les emblématiques pâtisseries comme Chabbakia ou l’makharka, très prisées pendant ramadan sont originaires d’Andalousie et leur consommation était limitée chez le milieu des nantis en raison de la rareté du sucre» témoigne Mohamed Houbaida.
Le miel étant la seule forme de sucre connue à l’époque, son utilisation relève de la pharmacopée et vendue exclusivement chez les Attars. En raison de cette rareté du sucre et du miel, ainsi que d’autres épices comme la cannelle, la Chabbakia, ainsi que d’autres sucreries étaient inaccessibles pour la plupart des Marocains quand elle n’est tout simplement pas inconnue dans certaines régions.

Avec le développement de l’importation du thé en raison des échanges commerciaux avec la Grande-Bretagne, le sucre allait faire son entrée dans la table marocaine.
Pendant le ramadan ou durant les autres mois, le poisson était quasi inexistant et les gens ne semblaient pas l’apprécier. Les documents de l’époque évoquent une consommation qui se limite aux poissons d’eau douce comme l’Alose (chabel, en darija) de l’oued Bouregreg ou encore Oum Rbiaa. De ce fait, le poisson était connu particulièrement des habitants de Salé, Rabat et Azemour.
«L’ouverture sur la mer est arrivée avec le protectorat. Le dynamisme des grandes villes impériales situées à l’intérieur du pays va s’estomper au profit des villes de la façade atlantique en raison de la construction des ports pour permettre les échanges avec l’étranger. C’est à partir de là que les Marocains découvrent la mer et ses métiers. Au niveau gastronomique, le poisson commencera à entrer dans les habitudes de consommation», affirme notre historien.

Au fil des années, l’essor de la pêche et du l’industrie des conserveries de poisson, sa consommation sera très popularisée.
Même si les Marocains subvenaient à peine à leurs besoins nutritionnels, le manque de moyen de transport, la pratique des ménages dans les maisons sans utilisation des machines modernes, ainsi que le fréquent déplacement à pied, forçaient les gens à pratiquer l’exercice physique et éviter l’obésité.

En un siècle, la population marocaine est passée de 4 millions à 35 millions. Une mutation démographique favorisée par les outils de la modernité. Ironie de l’histoire, la nourriture, jadis si rare, pose actuellement de graves problèmes de santé publique.